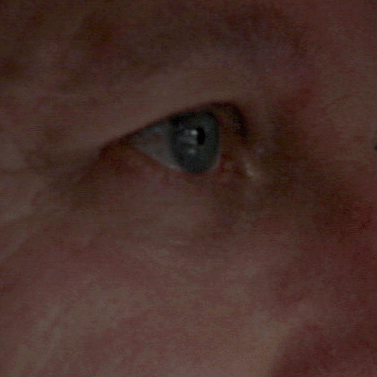Entretien avec Nicolas Philibert
Bertrand Bacqué : Pourquoi, en devenant cinéaste, avoir choisi le documentaire ?
Nicolas Philibert : Ce n’est pas quelque chose que j’ai décrété comme ça, un beau matin en sautant de mon lit. Il se trouve que mon premier projet a été un documentaire, La Voix de son maître, et puis après, ça s’est enchaîné au gré des événements. Je ne m'interdis pas de faire un jour de la fiction, mais ce qui me plaît, dans le documentaire, c’est de ne pas savoir où je vais, de devoir chercher le film jusqu’au bout, sans programme ni plan de travail. D’où un sentiment mélangé de liberté et d’incertitude, une fragilité qui me pousse à être constamment sur le qui-vive. Pour moi, un film est toujours une sorte de quête, un besoin d’aller à la rencontre de quelque chose ou de quelqu’un que je ne connais pas, de me confronter à une part d’inconnu.
Barbara Levendangeur : Qu'est-ce qui vous motive pour faire un film ? Y a-t-il un déclic initial ?
N. P. : Il peut y avoir un déclic, lié à une rencontre, à la visite d’un lieu, à une histoire qu’on m’aurait racontée, mais ensuite, il faut que cela mûrisse et chez moi, en général, c’est un processus lent. Ce qui me décide, ce n’est pas le « sujet » en tant que tel, mais les questions qu’il charrie et qu’il va m’obliger à me poser. En un sens, les sujets de films courent les rues. Tout peut devenir intéressant, c’est une question de regard. Le sujet apparemment le plus banal peut donner un film magnifique. Mais il faut quelque chose de plus. Un projet n’a d’intérêt à mes yeux que s’il travaille au corps mon propre cinéma. Prenez La Moindre des choses : la première fois que je suis allé à la clinique de La Borde, j’avais un tas de préjugés sur la folie, beaucoup de scrupules à l’idée de venir pointer une caméra sur des gens qui sont dans la souffrance psychique, et je n’avais pas du tout envie de tourner dans un endroit pareil ! Mais peu à peu, l’idée même d’un film qui me confronterait à mes scrupules, à ma peur, aux questions que je me posais, a pris le dessus.
B. B. : Quel temps consacrez-vous à la préparation et aux repérages ?
N. P. : C’est variable, mais en général assez peu. Je dis volontiers que « moins j'en sais sur le sujet, mieux je me porte ! » ça veut dire que je ne fais pas mes films à partir d’une masse de connaissances qu’il s’agirait de reproduire ou d’asséner au spectateur. Au contraire, ce qui me guide, c’est mon ignorance, mon désir d’y comprendre quelque chose. J'essaie de me soustraire à cette emprise du sujet si souvent pesante encore dans la sphère du documentaire. De quoi ça parle ? C'est sur quoi, au juste ? Qu’est-ce que ça va raconter ? Parfois, je n'en sais rien… Alors, je fais le film pour essayer de le savoir.
B. L. : C'est la différence avec le reportage télé ?
N. P. : Dans le reportage télé, le réalisateur filme pour illustrer une idée définie en amont. Bien souvent, tout est joué d’avance. Du coup, il n’y a pas de rencontre possible. Il n’y a de vraie rencontre que si on ne sait pas où elle nous mène. Mais il y a une autre différence : dans le documentaire, le cinéaste affirme la subjectivité de son point de vue. Alors que dans le reportage, il la tait, il la nie, en voulant nous faire croire à la neutralité de son regard.
B. B. : Quelle est votre position par rapport à ceux qui prônent l'invisibilité totale et dont le but, en filmant, est de se faire complètement oublier ?
N. P. : Je ne crois pas une seconde qu'il soit possible de se faire oublier, mais surtout, cette prétention à vouloir le faire a quelque chose de suspect. La présence d’une équipe, même celle d’un type qui filme tout seul, change forcément les choses. On peut souhaiter ne pas trop perturber ceux qu’on filme, veiller à ne pas exacerber le comportement de tel ou tel, essayer d’être discret, mais faire semblant de croire qu’une caméra n’aurait aucune incidence sur la réalité me paraît totalement naïf. Ce qui compte, ce n’est pas de se faire oublier, c’est de se faire accepter ! Et pour se faire accepter, il faut montrer qu’on n’est pas là pour filmer à tout prix, dans n’importe quelle situation, en forçant les portes. Une caméra donne un énorme pouvoir à celui qui l’a entre les mains. Il s’agit de ne pas en abuser ! Il me semble aussi important de savoir renoncer à filmer que de savoir filmer. Surtout aujourd’hui, avec le numérique, la multiplication des caméras DV, et le triomphe de la télé-réalité. Mais il y encore autre chose : prétendre « se faire oublier » revient à vouloir faire croire au spectateur que ce qu’il voit, c’est LA réalité, la réalité brute, et c’est entretenir le malentendu.
B. L. : Justement, il y a des choses que vous provoquez, que vous mettez en scène. Comme dans Être et avoir, où vous avez proposé à un enfant de faire une multiplication à la maison…
N. P. : La démarche documentaire peut parfaitement intégrer le fait de suggérer des situations. Naturellement, le terme « provoquer » a une connotation un peu péjorative, parce qu’il laisse entendre qu'on pousserait les gens à faire des choses contre leur gré, ou qui leur seraient étrangères. Mais ce n’est absolument pas ça ! Dans le documentaire, les gens qu’on filme, on les choisit pour ce qu’ils sont, pas pour leurs talents supposés de comédiens. Nous mettons précisément tout en œuvre pour qu’ils restent eux-mêmes face à la caméra. Proposer une situation, ce n’est donc pas pour qu’ils renoncent à être authentiques, qu’ils simulent ou qu’ils fassent semblant. Au contraire, c’est dans l’espoir que leur personnalité pourra pleinement se déployer. Par ailleurs, puisque vous parlez de « mise en scène » du réel, il faut bien voir que le geste de filmer n’est jamais neutre, même quand on filme une situation « sur le vif ». Selon qu’on mettra la caméra ici ou là, qu’on filmera en plan fixe ou en mouvement… on en donnera des lectures différentes.
B. B. : La mise en récit s'amorce pendant le tournage. Quelle est la part du récit qui se fait au tournage, quelle est celle qui se fait au montage ?
N. P. : Pour chacun de mes films, le montage a été une aventure différente. Pour La Ville Louvre, j'ai monté des scènes en séquences puis, j'ai commencé à les mettre en ordre. Bien sûr, j'ai été amené à les retravailler, puis à les déplacer de nouveau. La Moindre des choses s'est montée tout à fait autrement. J'ai d'abord longuement réfléchi à ce que devait être la première séquence. Ensuite, j'ai monté les scènes unes après les autres sans jamais en déplacer une seule. Pour Être et avoir, j'ai commencé par la fin. J'ai monté les dernières scènes puis suis remonté dans le temps. À un certain moment, je me suis trouvé un peu bloqué. Du coup, j'ai creusé le tunnel par l'autre bout et j'ai recommencé par le début… Quant à la part du récit qui se fait au montage et au tournage, c'est compliqué, parce que les deux étapes s’interpénètrent tout le temps. Quand on tourne, on anticipe très souvent sur le montage, on pense à la manière dont on pourra monter ce qu’on est en train de filmer. Par ailleurs, quand on tourne comme je le fais, sans programme préétabli, en improvisant beaucoup, on se dit parfois que le tournage pourrait continuer encore des semaines entières, et pourtant, c’est curieux, mais un beau jour on a le sentiment que c’est fini, qu’il est temps d’arrêter. Pourquoi ? Peut-être parce qu’on n’a plus d’idées, qu’on s’essouffle, et que désormais on ne pourra plus avancer que sur la table de montage.
B. B. : Le montage n'est-il pas avant tout musical ?
N. P. : Oui, le cinéma a beaucoup plus à voir avec la musique qu'avec le théâtre ou tout autre forme d'art. Un film, c'est des longues et des brèves, des ellipses, des silences, des timbres de voix, des pleins et des creux, du visible et de l'invisible. C’est parce qu’il y a des ellipses, du non-dit, du hors champ, de l’absence, qu’un film peut donner à penser. Quand un film devance toutes les questions, il nous empêche de penser.
B. L. : Est-ce que les suites judiciaires d'Être et avoir ont fondamentalement changé votre regard sur la pratique du documentaire ?
N. P. : Ces histoires n’ont pas ébranlé les convictions qui sont les miennes ; à savoir qu’une démarche documentaire fondée sur la rencontre comporte nécessairement une part de risques, et que ces risques valent la peine d’être pris. Ces mésaventures judiciaires ne me feront donc pas renoncer à explorer la voie que j’ai choisie. Bien sûr, elles ont permis de poser certaines questions, comme celle de la rémunération des personnes qu’on filme, mais les réponses que la justice leur a apportées sont sans ambiguïté et constituent un socle très important pour l’avenir. Le tribunal a clairement signifié à l’instituteur que contrairement à ce qu’il tentait d’établir, et malgré toute la considération qu’on peut avoir pour la façon dont il exerce son métier, il n’était ni co-auteur du film, ni artiste interprète. Les juges ont également reconnu que le film ne constituait aucune atteinte à son image, et qu’il n’y avait pas contrefaçon. Monsieur Lopez a donc été débouté sur tous les points, et je crois que tous les amateurs de documentaires, qu’ils en soient les « acteurs » ou simples spectateurs, peuvent s’en féliciter… jusqu’à la prochaine offensive !
B. B. : Votre regard sur la réalité élabore un monde qui a une certaine cohérence. Quelles valeurs ce monde véhicule-t-il ? Que voulez-vous transmettre ?
N. P. : Il ne s'agit pas pour moi de transmettre des valeurs, mais de poser des questions. Un film est fait de toutes les questions qu'on se pose à un moment donné, et dont on ne sait pas si elles croiseront celles des autres. Il se peut qu’il y ait chez moi des constantes, des questions qui reviennent, parce qu'elles n'ont pas trouvé de réponses… même s'il y a parfois un semblant de résolution. Mais les questions se déplacent, et vous poussent à faire un autre film. Ce n'est pas avec l'envie de dire que je fais des films, mais avec les interrogations et les doutes que je porte.