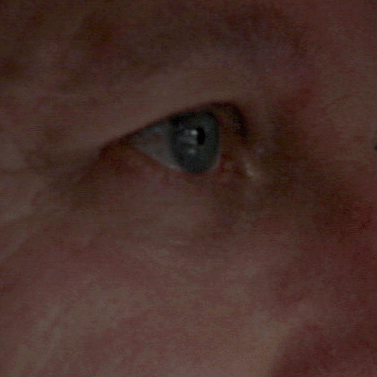En douceur
* in « Nicolas Philibert, les films, le cinéma », sous la direction de Luciano Barisone et Carlo Chatrian à l’occasion d’une rétrospective N. Philibert à Alba (Italie) - Infinity Festival, mars-avril 2003.
Nicolas Philibert sait attendre. C'est la marque la plus évidente de son style. Il n'est pas certain qu'il ait plus de patience qu'un autre cinéaste. Il serait même secrètement impatient. Je me souviens lors du tournage de La Ville Louvre, de sa fréquente insatisfaction de ne pas avoir saisi, pour conclure une séquence, telle ou telle « mise en scène » de la vie quotidienne du musée monumental. Son impatience se transforme singulièrement en une pugnacité de l'attente. Pourtant, je ne suis pas convaincu qu'il soit au long d'un tournage satisfait de « trouver » ce qu'il cherche. Mais l'attente fait son oeuvre. Elle apporte sa part de "synchronisme accidentel", selon l'expression de Jean Cocteau, qui excède largement, au final, la quête de Philibert.
Cela dit, laisser-venir-les-choses-à-soi pourrait être le credo de tout documentariste. Mais ce credo ne résume pas le style de Philibert. Le cinéaste des sourds, des « fous », des animaux naturalisés, des jeunes comédiens et des élèves d'une attendrissante classe unique, n'est pas passif.
En premier lieu, c'est l'action d'aller à-la-rencontre-de qui caractérise son écriture.
En second lieu, ce sont les communautés fortement structurées qui l'attirent.
La précédente énumération de certaines de ces communautés révèle le goût du cinéaste pour ce qui (se) trame et ce qui circule dans tout groupe humain. C'est principalement ce qui le fascine : l'humain quand il est rassemblé selon un critère institutionnel fortement affirmé (le musée, l'asile, la scène théâtrale, l'institut de sourds et muets, l'école). Au fond, les momies animales du Museum d'Histoire Naturelle auraient peut-être une vocation caricaturale et humoristique pour résumer cette obsession de Philibert pour l'humain institutionnalisé. Je ne connais pas d'équivalent chez les documentaristes contemporains, qui soient dotés d'une telle puissance analytique avec les seuls moyens du cinéma pour représenter les tensions et les adaptations à l'institution. En fait, Philibert suppose implicitement un « homo institutionnalisé » (!).
Le caractère disparate des éléments qui composent tout film documentaire est ce à quoi un cinéaste est soumis. Par définition, ce genre cinématographique est confronté au chaos du réel, à l'absence de hiérarchie dans laquelle le monde s'offre à la représentation.
On pourrait sans doute répartir les meilleurs documentaristes en deux catégories. Ceux qui accentuent l'apparent désordre pour le restituer en une écriture délibérément dispersée, éclatée, et laisser au spectateur la responsabilité relative de recomposer une cohérence narrative intelligible. Et ceux qui tentent au contraire, de gommer les conflits aléatoires de la matière du réel physique et sociale, de napper le visible par l'habile continuité d'un filmage et la virtuosité du montage mais n'en épargnent pas moins le spectateur. Philibert appartient à cette seconde catégorie.
Son style est fluide. Particulièrement fluide. Les contradictions affleurent grâce à ce que je n'hésiterai pas à nommer une mise en scène.
La longueur d'un plan dans un film de Philibert excède en général ce moment où le plan paraît avoir donner tout son potentiel informatif. Et cette ténacité d'observation qui accroît un sentiment de continuité fait apparaître en revanche une discontinuité, celle des tensions dans la réalité.
Mais il faut une exceptionnelle confiance en soi et surtout dans le spectateur pour continuer un plan au delà du sens qu'il paraît avoir épuisé. Et cet enchaînement de plans ou de ou de séquences qui vont au delà de l'information pour atteindre un jugement, confère à Philibert son statut d'auteur.
Les exemples de ces plans-séquences sont nombreux: de la scène burlesque dans La Ville Louvre au cours de laquelle les conservateurs exécutent une danse curieuse qui traduit leur incertitudes d'accrochage des tableaux, à la répétition familiale de la table de multiplication dans Etre et avoir.
Il ne s'agit donc pas seulement d'attendre. Il s'agit de tendre au maximum les potentialités de sens d'un plan-séquence et de monter ce dernier selon ses points d'épuisement. Cela devrait engendrer un cinéma énervé, sinon hystérique et tapageur (genre Michael Moore). Au contraire, c'est en douceur que s'affichent les points de tension qui gisent, peu perceptibles, dans le monde observé. En douceur donc que s'effectuent les enquêtes de Philibert. La musique est simplement là (celle souvent exemplaire de Philippe Hersant) pour avertir du moment où le cinéaste prend son parti d'aller plus loin que ce qui s'offre d'emblée, autrement dit plus loin que ce qu'on nomme, parfois savamment en théorie de l'art, le pittoresque.
Pourquoi faudrait-il supposer comme intangible le principe selon lequel la facilité pittoresque serait conjurée par la seule brutale radicalité formelle?
Non, c'est toujours en douceur qu'agit Philibert et c'est d'ailleurs cette même impression qui ressort paradoxalement de la coïncidence inouie entre les secousses politiques traduites par l'électorat français en mai 2002 et le sujet d'Etre et avoir.
L'homme en institution et la douceur. Singulier mélange entre un sujet et une manière. Souvent dotés de l'un ou de l'autre, les cinéastes documentaristes accèdent rarement au statut d'auteur. En six ou sept films, Nicolas Philibert a définitivement imposé l'évidence de ce statut encore trop réservé au seul domaine du cinéma de fiction.