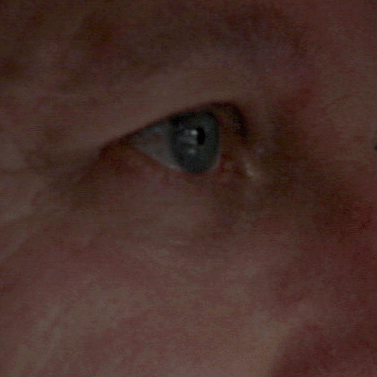Un cinéma qui cicatrise
* texte paru simultanément dans la revue Images documentaires n°45/46 (3e et 4e trimestres 2002) et dans « Nicolas Philibert, les films, le cinéma » (ouvrage sous la direction de Luciano Barisone et Carlo Chatrian, à l’occasion d’une rétrospective N. Philibert à Alba (Italie) - Infinity Festival - mars/avril 2003.
Être et avoir a été attaqué pour deux mauvaises raisons. La première critique adressée au dernier film de Nicolas Philibert se fonde sur l’image de l’école, jugée non représentative, qu’il nous propose. La seconde attaque dont il fut l’objet concerne le personnage principal, le maître. Il n’incarnerait pas l’idéal de sa place. Pire, il ne l’occuperait pas, préférant s’en attribuer d’autres (« père », « mère », « psychologue » etc.). Il y aurait donc, dans les deux cas, un délit de non ressemblance. Ce qui sous-entend que le documentaire devrait répondre, avant même de savoir s’il est bon ou mauvais, à des critères de représentation de la réalité d’ordre sociologique. Pire, le documentaire devrait être représentatif. Dans une culture de l’information désormais dominante (pour ne pas dire hégémonique), la vérité se confond avec la représentativité. Une école, aujourd’hui, majoritairement, se situe en zone urbaine. Filmer l’école d’un petit village du Puy de Dôme devient dès lors un péché de nostalgie, une sorte de complaisance pour un passé résolu, une illusion dangereuse, voire même une imposture, une supercherie. Quant au maître tel qu’il nous est présenté, de la même manière, il n’est pas identifiable. Ni à sa fonction (qui semble partir dans tous les sens), ni à sa vie quotidienne (dont nous ignorons à peu près tout en dehors de son travail). Nicolas Philibert devra donc être brûlé en place publique pour non-respect du contrat supposé avec le spectateur de documentaire. Ce que contiennent ces critiques, c’est un principe supposé selon lequel le cinéma documentaire n’aurait pas les mêmes droits que le cinéma de fiction. Il aurait même des devoirs en plus : respecter des pourcentages, représenter un archétype, un portrait robot, un instantané du présent. Il devrait informer comme une sorte de sondage en images. Or le cinéma de Nicolas Philibert parle d’autre chose, et ce depuis longtemps, sans que ça ne se sache trop. Lorsqu’il filme une institution qui accueille des sourds-muets ou des malentendants (Le Pays des sourds), il nous parle de l’échange et de l’apprentissage (de la langue, de l’autre, de la vie). Lorsqu’il va à la clinique de La Borde (La Moindre des choses), il nous montre la solitude et la tentative d’y échapper. À chaque fois, en apparence, le « sujet », la commande semblent traités. Tiens, un film sur les sourds… Tiens, un autre sur les fous… Et puis un troisième sur un musée (La Ville Louvre). On devrait faire plus attention aux titres des films : Le pays… La ville… Ces formules nous ramènent de manière explicite au pays du conte. Il était une fois… Il était une fois une petite école dans une grande forêt, avec d’immenses arbres aux contours inquiétants… Il était une fois un havre de paix dans une nature hostile, aride et rude où le froid gèle les doigts, brûle la peau et fait glisser les voitures dans les fossés et les ravins. Il était une fois un lieu chaud et douillet où il ne sentait pas, comme à l’étable, l’odeur du fumier, où l’on pouvait se parler sans entendre le bruit assourdissant de la trayeuse électrique, où un adulte avait enfin le temps de nous aider, de nous écouter, nous, les enfants de ce drôle de pays qui existe et qui n’existe pas et que tous reconnaissent car tous ont eu un jour quelqu’un pour leur raconter l’histoire du Petit Poucet. Voilà le crime : faire, à travers un documentaire, à partir du matériau réel, une fiction. Ne pas faire de l’exemplarité, de la dénonciation, du misérabilisme (trois fondements du docu télé le plus ennuyeux). Faire avec une réalité une fiction qui parle à tout le monde. Mais de quoi ça nous parle, Etre et avoir ? C’est là qu’il est temps d’aller y voir de plus près, du côté du maître. Non pas que le film se cantonne à un portrait, loin s’en faut. C’est vrai que ce Monsieur Lopez joue un rôle central, il porte le film, il l’enchante, il l’habite. Mais jamais le film ne se limite à lui. Jamais il ne réduit les autres, les enfants, à de purs instruments. C’est bien un monde qu’on nous révèle, un monde dont les parents s’imaginent qu’il s’appelle l’école…
(lignes à lire en chantonnant, comme une comptine)
…l’école où on apprend,
à lire et à écrire,
à chanter et à compter,
à apprendre, à réciter…
Mais le film, lui, nous montre autre chose. Ce lieu là, je l’ai dit, est un havre, une bulle, un temps et un espace suspendus dans lequel une sorte de communion a lieu : communion autour de l’apprentissage, communion autour du travail et du jeu, communion autour de l’être en commun et surtout communion autour d’un maître idéal. Alors, parlons-en, de ce maître. Idéal, pas pour tout le monde, apparemment, si on lit les critiques assassines de nos « philosophes » puritains qui ont conservé du gauchisme des manières de grands Inquisiteurs. Idéal pour des enfants dont cet homme mystérieux, à la voix si douce, qui ne s’énerve jamais, cautérise les plaies. Dont la voix apaise les grandes peurs, la violence familiale, la violence du Monde, la violence de la vie. Là encore, du conte. Un être mythique, un personnage hybride, mi-dieu, mi-homme, un personnage secret et solitaire (a-t-il une vie sexuelle ? Amoureuse ? Rien ne le dit), qui part et revient chaque jour de nulle part, qui surgit dans son automobile. Un qui sait écouter, un qui sait s’attendrir, un qui sait prendre patience, un qui sait limiter. Etre et avoir, c’est ça : un conte moderne fondé sur du réel, avec un lieu et un personnage mythiques qui traversent la vie des élèves et celle des spectateurs en leur faisant du bien. Et qu’on ne me dise pas qu’il y a supercherie ou alors pour les sourds et les aveugles. Lorsqu’on nous montre ce pays aux paysages grandioses et inquiétants, lorsque Philibert filme la recherche de la petite fille disparue, qu’on ne me dise pas que ça nous est donné à voir de manière documentaire, vériste. Qu’on ne me dise pas qu’à cet instant, dans ce grand champ pas encore moissonné où les silhouettes des enfants disparaissent dans les herbes, où chacun s’égare et appelle désespérément, on n’a pas basculé depuis longtemps dans le monde de nos rêves et de nos cauchemars ; la manière même dont l’affaire se conclut -juste une voix, je crois, qui annonce qu’on a retrouvé la fillette- nous indique bien qu’on n’est pas dans le reportage mais bien dans la fiction. Car ce que n’ont pas compris ces gens qui n’ont plus de leur enfance qu’un souvenir lointain et déformé, c’est que le cinéma de Philibert a une fonction : celle de la réparation.
Tout comme cet homme, cet instituteur, nous raconte comment enseigner revient pour lui à réparer la souffrance du père, les films de Philibert s’adressent avant tout au spectateur. Non pas pour l’informer, pour le documenter, mais dans ce qu’ils pressentent de son intérêt (au spectateur) pour les sourds, les fous et les enfants. De ce qu’il vient y chercher. Et ça, la télé ne le comprendra jamais. Ce qu’il vient chercher, c’est un entre-deux. Entre l’autre et soi, entre ce qui ne nous appartient pas, ce que nous ignorons, ce qui fait partie de l’autre monde et ce qui, à travers cette altérité irréductible, vient nous parler de nous. Nous ne cherchons donc pas à nous informer mais à mesurer, proximité et différence, à évaluer la distance, à s’égarer dans les limbes, les frontières indécises, les entre-deux féconds où les mots, la pensée, l’analyse ne suffisent plus à comprendre, à saisir, à ressentir. C’est justement dans la singularité poussée à l’extrême par une mise en scène qui ne cache pas son interventionnisme que quelque chose surgit que nous reconnaissons de notre lien à l’autre, de notre rapport au monde, du mystère de la vie. Et cette intervention de la mise en scène s’opère non seulement dans le choix de sujets filmés comme autant de petits théâtres, de petites scènes, de petits drames (espace) mais aussi dans l’ordonnancement des séquences (temps). Je pense que Philibert est un grand monteur, au sens où il parvient à construire ses films d’une manière très proche de celle d’un scénario de fiction sans jamais forcer le trait, sans jamais rigidifier l’ensemble. Par exemple, dans La Moindre des choses, on pourrait réduire l’intrigue du film au spectacle qui s’élabore au sein de l’institution psychiatrique. Le film, lui ne se laisse jamais enfermer dans cette problématique. Il l’outrepasse, tout le temps, dans le suivi des personnages, dans la manière d’ouvrir et de clore le récit, par-delà ce qui va un moment servir de ligne conductrice. D’une autre façon, dans Etre et avoir, le cadre de l’école déborde de toute part : confidence d’un enfant qui a perdu un parent, sortie extra scolaire, bref interview du maître sur « d’où il vient », ses origines d’immigrant. Le récit s’autorise aussi une digression sur le travail scolaire à la maison quand on découvre la famille réunie autour de la table pour « aider le petit » (séquence jubilatoire où chacun vient mettre son grain de sel). C’est grâce à ces chemins de traverses que nous parvenons à faire le lien, à nous y retrouver, à ne pas enfermer nos sensations, nos impressions, nos réflexions dans un cadre trop rigide, trop identifiable (aujourd’hui « l’école », hier « les fous », « les sourds » ou « la vie d’un musée »). Ce que Philibert répare, à travers son cinéma, ce sont nos plaies et nos bosses, nos désenchantements, notre désillusion. Au cours de sa mission (car il y a bien quelque chose de religieux dans le rôle qu’il attribue au cinéaste, sorte d’apôtre protecteur qui relie les liens cassés, distendus), Philibert ne tombe jamais dans le discours bien pensant, dans l’optimisme à tout crin, dans la solutionnite aiguë. La souffrance est là, palpable. Les plaies sont là, longues à cicatriser. Mais le bien fait son œuvre. Alors, bien sûr, on pourra dire que Philibert évite les sujets qui fâchent, les endroits où ça brûle, les questions qui dérangent. Lorsqu’il filme à La Borde, la question pourtant centrale du recours aux traitements psychiatriques classiques (neuroleptiques notamment) n’est pas abordée. Juste un gros plan de mains d’infirmier remplissant des verres de gélules multicolores vient nous rappeler que ces patients sont soumis à des chimiothérapies intensives, limites d’une expérience que le film n’affronte pas. Pas plus qu’il n’évoque les effets de ces traitements puissants qu’on continue de qualifier de « secondaires » là où ils transforment fondamentalement l’aspect, l’attitude et la perception des pensionnaires. C’est la limite de son cinéma, d’être non pas « du côté » mais « à côté » du pouvoir (pas n’importe lequel quand même, un pouvoir « humain »), limite qu’on peut critiquer mais sans laquelle il ne peut plus y avoir cette fonction subtilement réparatrice. Car le cinéma de Philibert n’est pas celui d’une modernité désenchantée « sans secret derrière la porte », comme disait Serge Daney, pas plus qu’un cinéma de dénonciation ; il n’est pas non plus la représentation d’une impossibilité, d’un hiatus entre les êtres ou la mise en scène de l’écart qui les sépare des institutions qu’ils représentent (c’est plutôt l’affaire de Depardon). C’est plus ancien que ça, ça vient d’avant, d’une idée très ancienne et très belle selon laquelle le cinéma est là un peu pour nous réparer, pour contrebalancer l’horreur du monde, pour être du côté de ceux qui souffrent, des opprimés. Un cinéma chrétien revisité. Il y a quelque chose de John Ford dans la manière qu’a Philibert de nous faire croire encore aux histoires sans nous rouler dans la farine. Un John Ford qui aurait pris en compte le chemin de la Modernité, sa démystification, son désenchantement, et qui chercherait, sans cynisme ni calcul, sans arnaque, sans esbroufe, à nous faire croire encore, ici et maintenant, dans le monde tel qu’il est. Quitte à le travestir, quitte à le transformer, quitte à le choisir, quitte à le reconstruire en gommant ce qui ferait trop mal, ce qui nous anéantirait, tuerait notre espoir. Mais cet acte de reconstruction (fictio, en latin, veut dire construire) s’opère sans jamais cacher l’artifice qui fait émerger la fiction au sein du réel (le montage, la musique, le lyrisme dans les plans sont là notamment pour nous le rappeler). Un cinéma qui, comme avant, aurait cette fonction de réparation, mais avec les outils et l’état de conscience d’un spectateur d’aujourd’hui. Traquer du mythe, du rêve et du désir pour continuer à vivre, simplement.
Mais ce qui fait surtout qu’on y croit, encore, à nouveau, à ces mythes, dans les films de Philibert, tient à la manière dont il nous montre qu’ils ont du plomb dans l’aile. Il est inquiet, le mythe. Il part en déconfiture, il pourrit, il moisit au fond d’un placard, dans une cave humide. Jusqu’au jour où des dames et des messieurs très sérieux, en blouse blanche, bleus de travail, costumes et lunettes cerclées de métal se penchent sur son chevet. Avec un grand sérieux, comme les sorciers d’antan, ils auscultent le malade, évaluent les dégâts, calculent le coût de la résurrection. Mais lorsqu’on les regarde de près, en y prenant le temps — ce que fait la caméra de Nicolas Philibert —, alors on voit sous leur masque d’adultes sérieux et compétents resurgir au coin de l’œil le plissement jubilatoire de l’enfant. Le réalisateur nous montre que maintenir en vie le rêve est une affaire sérieuse, un travail important qu’il faut savoir confier à de grands enfants. Qu’il s’agisse de ces messieurs et dames très érudits du Muséum d’Histoire naturelle (Un animal, des animaux) ou des 1 500 employés du musée parisien (La Ville Louvre), ils ont tous en commun cette profonde application des enfants quand ils jouent. En face d’eux, rien que des objets apparemment. Tout au plus, des œuvres d’art. Mais là encore, l’insistance de la caméra, le contre-champ saugrenu qui surprend l’expression, ici d’une statue antique, là d’un babouin empaillé, nous disent autre chose. Ceux-là, d’en face, semblent dotés d’une présence, celle des morts, celle des errants et lorsqu’on vient les réveiller au fond de leur oubli, ils semblent pris entre stupéfaction, crainte et ironie de voir tous ces vivants s’affairer si sérieusement, avec tant de moyens, tant de vanité mais aussi tant d’amour, autour de leurs vieilles dépouilles. Que vont-ils encore faire de nous ? A quelle nouvelle mise en scène vont-ils nous assaisonner ? Ce qu’on sent poindre, derrière l’inquiétude, c’est la présence palpable de la vie dans ces objets inanimés dont on ne doute plus qu’ils aient une âme. Comment oublier, dans Un animal, des animaux, ce contrechamp merveilleux d’un gibbon ou d’autres animaux intrigants qui semblent éberlués en entendant la très sérieuse conservatrice expliquer à ses collègues de sa voix pointue que « la communauté scientifique est tout à fait satisfaite »… Dans cette manière de redonner un droit d’exister au sein du montage à ceux qu’on n’avait fini par ne plus considérer que comme de simples choses, le film vient nous rappeler la relativité, la drôlerie et la nécessité de l’œuvre humaine à travers son goût obsédant de la conservation. Et il nous met dans le coup, nous associe au travail, nous autres spectateurs, nous fait participer de par notre regard à cette résurrection. Comme on répare les statues, on recolle ses vieux mythes, on les remet en forme, inépuisables sources de rêve, représentations essentielles de nos peurs, de nos craintes et de nos démons dans un monde qui ne jure plus que par la science et l’information.
Pourtant cette réparation semblerait artificielle, réductrice, bien pensante si elle n’était pas, en toute fin, traversée par un sentiment irréductible. Entre le regard du vieil homme qui supervise les derniers préparatifs avant la réouverture de la galerie de l’évolution, les larmes à peine masquées de l’instituteur lorsqu’il quitte « ses » enfants le dernier jour de l’année, le regard perdu de ces animaux naturalisés et celui, profond comme les abîmes qu’il a dominés, de l’alpiniste Christophe Profit dans Trilogie pour un homme seul, on sent poindre la même profondeur sans fin, la même solitude. Celle de l’enfant qui pleure dans Le Pays des sourds parce qu’il n’a pu poster la lettre avec ses copains… celle de cette silhouette enfantine dans un labyrinthe de miroirs… Mais cette solitude là, belle, grande, encore portée par les rêves, hantée par les souvenirs des morts, par les blessures passées, sait s’entourer des autres sans jamais oublier. Comme dans cette si belle et si simple remise des prix en fin d’année aux élèves mal entendant de l’école du Pays des sourds » , on retrouve les trois éléments qui constituent le petit théâtre de Nicolas Philibert : celui qui est en danger (l’enfant, le fou, l’alpiniste), celui qui donne et qui transmet (le prof, le savant, l’infirmier) et l’objet mythique, parfois en déshérence mais qui conserve malgré tout sa fonction symbolique (le prix, le sommet vaincu, le vestige restauré, le spectacle créé, l’œuvre d’art rénovée), qui fait toujours lien grâce à sa nouvelle résurrection. Comme le cinéma classique pour le spectateur, chaque fois, on est surpris, ça (re)marche alors qu’on n’y croyait plus.